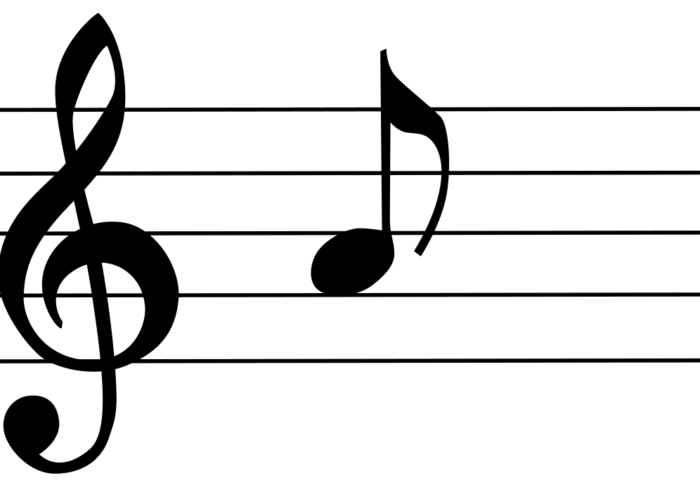La plus belle des distances
Extrait du volume 3 de mon autobiographie à paraître le 1er avril
Lyon, dimanche 24 avril 1989
J’ai tout entendu de celle que j’appelle la plus belle des distances, la plus redoutée à cette époque où la surenchère aux kilomètres n’a pas encore été lancée. Le marathonien percute « le Mur » quand il a intégralement épuisé ses réserves de glycogène, l’énergie stockée dans les muscles. Une fois le réservoir vide, l’organisme va « taper dans le gras » : aller chercher les matières grasses dans le foie, le pancréas… Chez un coureur entraîné, cette inversion du métabolisme se fait facilement : son corps a été mis en condition lors des sorties longues pouvant aller jusqu’à 35 km. Je n’ai pour ma part jamais dépassé 25 km à l’entraînement.
Les dés sont jetés. En plus de comprimés à croquer de glucose et d’arnica – la Sporténine -, j’ai pris des granules homéopathiques pour atténuer la douleur au genou. Je boitille, même en marchant. Mais rien ne pourra me déstabiliser, chargé d’une confiance en moi inextinguible, même si je suis loin d’être frais comme il le faudrait : j’ai couru le triathlon de la Grande Motte dimanche dernier. « Être frais, avoir du jus » : avoir récupéré des efforts, avoir rechargé les batteries, s’être reposé la semaine précédente. C’est la clef d’un Marathon réussi.
42,195 kilomètres… Mais, pourquoi ce nombre pas vraiment rond ? À l’occasion des JO de 1908 de Londres, la famille royale exige que le départ soit donné au château de Windsor et que l’arrivée soit jugée devant la loge d’Édouard VII au White City Stadium, ajoutant ainsi 385 yards aux 26 miles initiaux. Ces 195 fameux mètres, ce nombre pas vraiment rond, portent le cerveau du coureur à ébullition quand tout au long de sa course il fait ses calculs, ses projections de temps d’arrivée. C’est mon premier et je ne me suis fixé aucun objectif de chrono, cela étant, avec un temps de 1 h 21 au semi, je peux théoriquement caresser l’espoir de passer sous les 3 h 00. Théoriquement, parce que je n’ai pas assez de bornes dans les pattes. Je ne cours pas plus de cinquante kilomètres par semaine. C’est largement insuffisant. Moins de 3 h 00, le graal.
Sur Marathon, tout peut arriver. Il faut que toutes les planètes soient alignées : avoir de l’expérience, avoir conduit un entraînement encore plus dur que la course elle-même, avoir observé une hygiène de vie draconienne, arriver frais le jour J, être au pic de sa forme. Et quand bien même, les conditions climatiques, la forme mentale, la régularité de l’allure sont autant de facteurs déterminants de la performance.
Nous sommes quelques milliers au départ, quai Achille Lignon, à notre droite le futur ex Palais des Congrès dont la démolition a commencé en vue de la construction de la Cité Internationale, à notre gauche, le Parc de la Tête d’Or. C’est là que j’ai commencé à courir, arpentant inlassablement le sentier circulaire de 3,890 km allant jusqu’à en faire 5, 6, 7 fois le tour. Je refais le film de l’avènement d’une passion.
Quelques années auparavant, le miroir au petit matin des nuits enfumées et alcoolisées me renvoyait l’image d’un type en pleine décrépitude qui n’irait pas bien loin dans la vie. L’index et le majeur droit jaunis par le tabac, les cernes à demeure, la peau au flétrissement bien précoce, ce ne pouvait pas être le même homme qui, gamin au Japon, encaissait des séances de natation dont la dureté était inimaginable en France, le même bipède drapé dans son kimono qui, après avoir observé le rituel d’avant combat face à son adversaire, se jetait courtoisement contre ce dernier, les deux combattants hurlant de concert un martial « Hajimé », le début du combat.
Ces quatre années passées au pays du soleil levant m’avaient imprégné d’une culture avec des valeurs – éducation, ambition, travail, patience et détermination – dans lesquelles je me reconnaîtrai éternellement, sans le savoir jusqu’à un certain point de ma vie, je ne sais à quel moment, puis en le conscientisant petit à petit quand je m’interrogeais sur les raisons de mes différences vis-à-vis de mes compatriotes, au travers de relations sociales compliquées. J’avais le sentiment de ne pas être compris. Par les amis, par les collègues également, puis par les clients. J’étais – et je suis – tout simplement différent. Au Japon, j’ai appris à repousser les limites de la douleur, à respecter l’autre, à ne briller que par l’humilité.
Dans les années soixante-dix, nul ne pouvait penser que le Japon allait devenir l’empire du Marathon. Qui aurait pu imaginer que le mythe apparu dans la Grèce antique serait érigé comme une religion de l’autre côté du globe plusieurs millénaires après ? Finalement, en quittant le Japon en 1974, j’avais certainement embarqué avec moi ce virus inoffensif – quoique. Quinze ans plus tard, je serai contaminé ce fameux lundi 24 avril 1989, une fois la ligne d’arrivée franchie. Mais combien de temps a pu durer la période d’incubation ? Et à quel moment me suis-je dit, la fleur au fusil, que j’allais en découdre ? Aucun souvenir précis si ce n’est celui d’étoiles dans les yeux quand j’avais assisté à l’arrivée du 1er Marathon de Lyon en 1983, c’était place Bellecour. Ce jour-là, une chose est sûre : le virus m’a chopé, puissamment. L’incubation aura duré six ans avec des symptômes avant-coureur quand le miroir me renvoyait l’image de ce mec décrépit : la solution tombait sous le sens, coulait de source, c’était limpide : courir, tout simplement. Nous sommes en 1985. La suite, ce sera aligner les bornes, en courant, en nageant, à vélo. Participer à mes premières courses, 10 km, semi-marathons, des triathlons, le corps se fortifiant et assimilant progressivement les charge d’entraînement. Aujourd’hui est donc autant un aboutissement que le début d’une aventure mentale et physique qui promet. 45 francs pour avoir le privilège d’être au départ.
9 h 00 pile, coup de pétard, c’est parti. J’enfile les ravitaillements, tous les 5 km, comme des perles, croisant à un bon 13 km/h. C’est génial, j’y suis, c’est le bonheur. J’ai mal mais je fais fi. Passage au semi en 1 h 37 sur un nuage, je pourrais accélérer mais ce serait l’erreur ultime. La douleur au genou commence à s’estomper, anesthésiée par les endorphines qui déferlent dans le corps. Il y a du monde, et les meilleurs vont en terminer alors que j’en suis juste au km 30. Un gars hilare lance à la cantonade : « On est à 13 ! ». 4’ 30” au kilo, pas mal.
Je reprends à mon compte « ça plane pour moi, ça plane pour moi !!! » qu’avait hurlé à tue-tête Plastic Bertrand lors d’un concert place des Terreaux. Je suis comme en lévitation : mon esprit et mes pensées se déconnectent des jambes qui courent toutes seules. Quand je suis dans cet état-là, je résous les problèmes insolubles, je me projette. Arrivé au km 25, je suis au Sénégal que nous allons visiter tous les quatre dans deux mois. Je refais la check-list : billets d’avion ? Traveller chèques ? Assurances ? Vaccins ? Je stocke toutes ces infos dans le bon tiroir de mon cerveau et hop, sujet suivant pour passer le temps. Tiens, ça fait un bout de temps que je bute sur la façon dont traiter cette interaction dans Voyage vers l’Orient, où l’élève doit calculer la distance qu’il a encore à parcourir depuis Venise jusqu’à Istanbul. Bon sang mais c’est bien sûr : je lui fais saisir la réponse sous la forme d’un nombre ou de lettres, mais sans lui demander l’unité km. Je stocke l’idée dans un autre tiroir en attendant de la mettre en application à la première heure lundi matin. Je soumettrai tout de même cette géniale élucubration à Christian.
Nous sommes dans Vaulx-en-Velin, à 8 km de l’arrivée au Parc. Domi m’attend avec Hugo et Lucas, je suis tellement pressé de les retrouver. Si je sens que je commence à puiser dans les forces restantes, tous les voyants sont au vert, il me reste seulement 7,195 km à parcourir, c’est de la rigolade… Je suis trop bien, pourquoi m’arriverait-il quoique ce soit ? Et soudain, comme un couperet, un coup de poignard, tout mon corps se trouve ébranlé, foulée désorganisée, bras flageolants, tête dodelinante.
Les chiffres et l’objectif chronométrique laissent place à l’épuisement et à la simple volonté de franchir la ligne d’arrivée. La vitesse chute inéluctablement et c’est un effort incommensurable que de simplement aller de l’avant. « Salut le Mur, bel enfoiré, tu as bien caché ton jeu, mais tu ne vas pas m’avoir comme ça ». Je me demande ce que je fous là et je signe un pacte avec moi-même en me promettant de ne plus jamais m’infliger un tel supplice. J’alterne marche et course un temps, puis, à l’approche du Parc, longeant le campus de la Doua, boulevard Bonnevay, je vais puiser tout au fond de moi pour boucler mon premier Marathon en 3’25’57, soit 12,5 km/h de moyenne.
Je suis exsangue, heureux, dans un autre monde, et je vais m’étaler de tout mon long sitôt la ligne franchie. Il y a plein de types autour de moi dans le même état, c’est la cour des miracles. Je prends du recul en me disant : « À quoi bon ? Pourquoi te mettre dans un état pareil ? Pourquoi cette obsession pour les minutes, les secondes ? Ce n’est pas ça qui va changer ta vie, merde. ». Eh bien, peut-être que si… Et si cette énergie dépensée en allant au bout du bout allait me permettre de ne jamais m’écrouler ? Oui, c’est ça, j’en avais l’intime conviction, mais maintenant que j’ai couru la plus belle des distances, j’en suis persuadé.
La vie est un Marathon… Et je pense déjà au prochain. Domi est là avec Hugo, Lucas dans la poussette. Elle m’a pris en photo juste à l’entrée du Parc, un beau cliché en noir et blanc, sans prix : elle a réussi la prouesse d’immortaliser ce moment, la mise au point est parfaite, combien de temps a-t-elle dû attendre, scrutant mon arrivée ? Le lendemain, je peine à me déplacer, et monter ou descendre une marche est douloureux, alors mes collègues compatissent en rigolant, ils ont bien raison tellement j’offre un drôle de spectacle, et je ris avec eux. Ils me tournent en dérision, mais ce n’est pas méchant de leur part, c’est sans doute leur façon de me dire « bravo ».